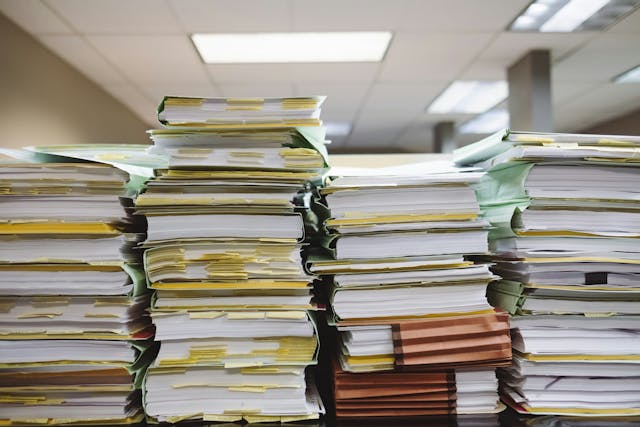OGBL : "Les femmes luxembourgeoises travailleront gratuitement jusqu'à la fin de l'année".

Getty Images
Au Luxembourg, comme dans de nombreux autres pays européens, l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes n'est plus une statistique abstraite. Selon l'écart officiel de 13,9 %, les femmes du 17 novembre "travaillent gratuitement" jusqu'à la fin de l'année. Mais derrière cette frontière symbolique se cache une discrimination systémique et invisible qui imprègne l'ensemble de la biographie professionnelle et sociale des femmes.
L'injustice ne se limite pas aux salaires. Elle s'infiltre dans le travail domestique, les soins aux enfants et aux proches, l'organisation de la vie quotidienne, la charge mentale. Selon l'OCDE, les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes d'effectuer un travail non rémunéré. Elles prennent en charge la planification, les soins, le soutien - tout ce qui est rarement pris en compte dans les statistiques officielles, mais qui permet à la société de se maintenir à flot.
Aujourd'hui, au Luxembourg, 36 % des femmes travaillent à temps partiel, contre moins de 8 % des hommes. Souvent, ce n'est pas par choix, mais parce qu'elles doivent s'occuper de la maison, des enfants et des parents âgés. Chaque heure "sous-travaillée" est un moins pour la pension, pour l'avancement de la carrière, pour l'indépendance financière. Il en résulte un écart de pension de 40 % entre les hommes et les femmes.
Et c'est à ce moment-là que le pays discute de réformes qui affectent directement l'équilibre entre le travail et la vie : révision du système de pension, augmentation du temps de travail dans le commerce, changements dans la législation du travail. Tout cela, souligne le syndicat OGBL, ne fait qu'exacerber les inégalités qui existent déjà - surtout si l'on ne tient pas compte de qui est payé "à l'abri des regards" et de combien.
Le département égalité de l'OGBL lance une enquête le 17 novembre sur la charge de travail mentale et l'emploi dans le secteur des soins - deux aspects qui figurent rarement dans les rapports mais qui définissent la réalité de millions de femmes.
Les femmes et les hommes sont invités à participer à l'enquête, car la question de la reconnaissance de ce travail concerne l'ensemble de la structure de la société, et pas seulement la "question des femmes".